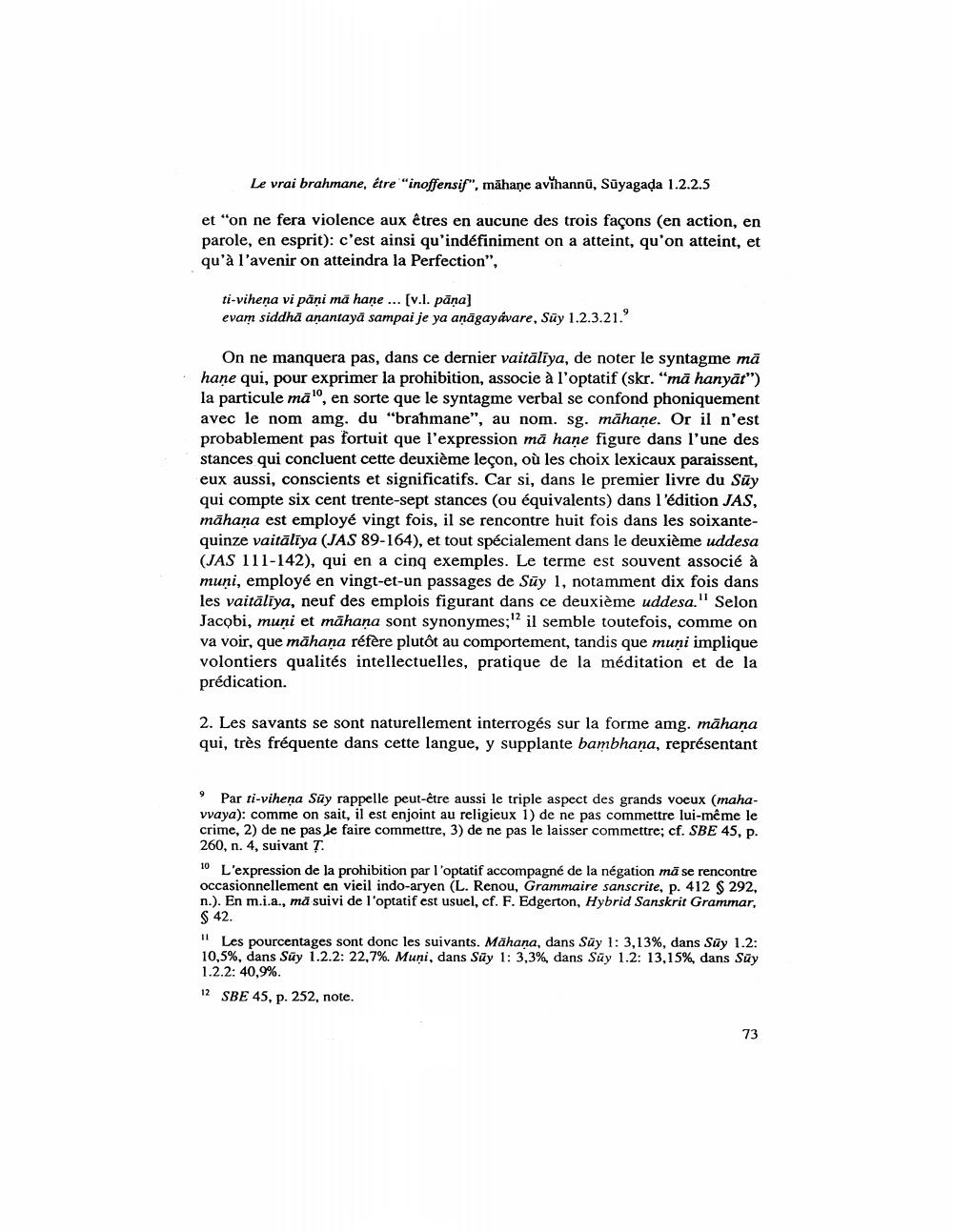Book Title: La Vrai Brahmane Etre Inoffensif Mahane Avihannu Suyagada Author(s): Colette Caillat Publisher: Colette Caillat View full book textPage 3
________________ Le vrai brahmane, être "inoffensif", mähane avihannü, Süyagada 1.2.2.5 et "on ne fera violence aux êtres en aucune des trois façons (en action, en parole, en esprit): c'est ainsi qu'indéfiniment on a atteint, qu'on atteint, et qu'à l'avenir on atteindra la Perfection", ti-vihena vi pāņi mā hane ... (v.l. pāna) evam siddhā anantaya sampai je ya anägayávare, Süy 1.2.3.21. On ne manquera pas, dans ce dernier vaitālīya, de noter le syntagme mā hane qui, pour exprimer la prohibition, associe à l'optatif (skr. "mā hanyāt") la particule mā", en sorte que le syntagme verbal se confond phoniquement avec le nom amg. du "brahmane", au nom. sg. māhane. Or il n'est probablement pas fortuit que l'expression mā hane figure dans l'une des stances qui concluent cette deuxième leçon, où les choix lexicaux paraissent, eux aussi, conscients et significatifs. Car si, dans le premier livre du Suy qui compte six cent trente-sept stances (ou équivalents) dans l'édition JAS, māhana est employé vingt fois, il se rencontre huit fois dans les soixantequinze vaitālīya (JAS 89-164), et tout spécialement dans le deuxième uddesa (JAS 111-142), qui en a cinq exemples. Le terme est souvent associé à muni, employé en vingt-et-un passages de Suy 1, notamment dix fois dans les vaitāliya, neuf des emplois figurant dans ce deuxième uddesa." Selon Jacobi, muni et mähana sont synonymes; il semble toutefois, comme on va voir, que māhana réfère plutôt au comportement, tandis que muni implique volontiers qualités intellectuelles, pratique de la méditation et de la prédication. 2. Les savants se sont naturellement interrogés sur la forme amg. māhana qui, très fréquente dans cette langue, y supplante bambhana, représentant ! Par ti-vihena Suy rappelle peut-être aussi le triple aspect des grands voeux (mahavvaya): comme on sait, il est enjoint au religieux 1) de ne pas commettre lui-même le crime, 2) de ne pas le faire commettre, 3) de ne pas le laisser commettre; cf. SBE 45, p. 260, n. 4, suivant Ț. 10 L'expression de la prohibition par l'optatif accompagné de la négation mä se rencontre occasionnellement en vieil indo-aryen (L. Renou, Grammaire sanscrite, p. 412 S 292, n.). En m.i.a., mä suivi de l'optatif est usuel, cf. F. Edgerton, Hybrid Sanskrit Grammar, S42. "Les pourcentages sont donc les suivants. Mähana, dans Süy 1: 3,13%, dans Sūy 1.2: 10,5%, dans Sūy 1.2.2: 22,7%. Muni, dans Sūy 1: 3,3%, dans Süy 1.2: 13,15%, dans Sūy 1.2.2: 40,9%. 12 SBE 45, p. 252, note. 73Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9