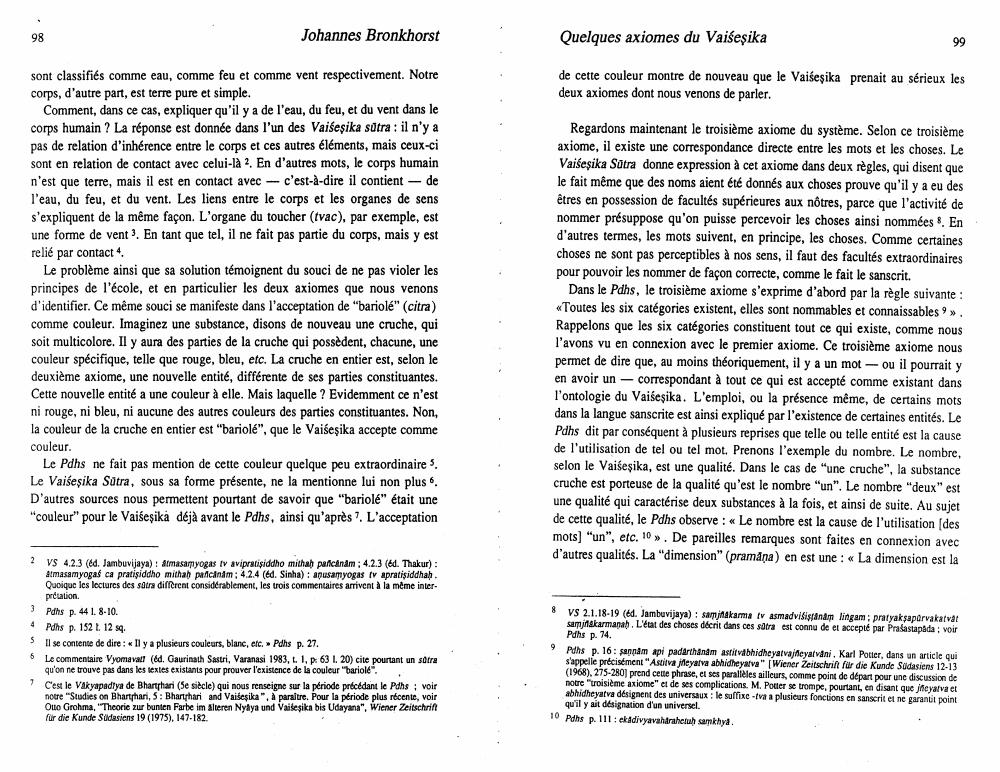Book Title: Quelques Axiomes Du Vaisesika Author(s): Johannes Bronkhorst Publisher: Johannes Bronkhorst View full book textPage 3
________________ Johannes Bronkhorst Quelques axiomes du Vaišeşika de cette couleur montre de nouveau que le Vaiśesika prenait au sérieux les deux axiomes dont nous venons de parler. sont classifiés comme eau, comme feu et comme vent respectivement. Notre corps, d'autre part, est terre pure et simple. Comment, dans ce cas, expliquer qu'il y a de l'eau, du feu, et du vent dans le corps humain ? La réponse est donnée dans l'un des Vaiśesika sútra: il n'y a pas de relation d'inhérence entre le corps et ces autres éléments, mais ceux-ci sont en relation de contact avec celui-là ? En d'autres mots, le corps humain n'est que terre, mais il est en contact avec c'est-à-dire il contient de l'eau, du feu, er du vent. Les liens entre le corps et les organes de sens s'expliquent de la même façon. L'organe du toucher (tvac), par exemple, est une forme de vent. En tant que tel, il ne fait pas partie du corps, mais y est relié par contact Le problème ainsi que sa solution témoignent du souci de ne pas violer les principes de l'école, et en particulier les deux axiomes que nous venons d'identifier. Ce même souci se manifeste dans l'acceptation de "bariolé" (citra) comme couleur. Imaginez une substance, disons de nouveau une cruche, qui soit multicolore. Il y aura des parties de la cruche qui possèdent, chacune, une couleur spécifique, telle que rouge, bleu, etc. La cruche en entier est, selon le deuxième axiome, une nouvelle entité, différente de ses parties constituantes. Cette nouvelle entité a une couleur à elle. Mais laquelle ? Evidemment ce n'est ni rouge, ni bleu, ni aucune des autres couleurs des parties constituantes. Non, la couleur de la cruche en entier est "bariolé", que le Vaišesika accepte comme couleur. Le Pdhs ne fait pas mention de cette couleur quelque peu extraordinaire 5. Le Vaiśesika Sotra, sous sa forme présente, ne la mentionne lui non plus D'autres sources nous permettent pourtant de savoir que "bariole" était une "couleur" pour le Vaišesika déjà avant le Pdhs, ainsi qu'après 7. L'acceptation Regardons maintenant le troisième axiome du système. Selon ce troisième axiome, il existe une correspondance directe entre les mots et les choses. Le Vai esika Sätra donne expression à cet axiome dans deux règles, qui disent que le fait même que des noms aient été donnés aux choses prouve qu'il y a eu des êtres en possession de facultés supérieures aux nôtres, parce que l'activité de nommer presuppose qu'on puisse percevoir les choses ainsi nommées. En d'autres termes, les mots suivent, en principe, les choses. Comme certaines choses ne sont pas perceptibles à nos sens, il faut des facultés extraordinaires pour pouvoir les nommer de façon correcte, comme le fait le sanscrit. Dans le Pdhs, le troisième axiome s'exprime d'abord par la règle suivante : «Toutes les six catégories existent, elles sont nommables et connaissables >> Rappelons que les six catégories constituent tout ce qui existe, comme nous l'avons vu en connexion avec le premier axiome. Ce troisième axiome nous permet de dire que, au moins théoriquement, il y a un mot ou il pourrait y en avoir un correspondant à tout ce qui est accepté comme existant dans I'ontologie du Vaišesika. L'emploi, ou la présence même, de certains mots dans la langue sanscrite est ainsi expliqué par l'existence de certaines entités. Le Pdhs dit par conséquent à plusieurs reprises que telle ou telle entité est la cause de l'utilisation de tel ou tel mot. Prenons l'exemple du nombre. Le nombre, selon le Vaišeşika, est une qualité. Dans le cas de "une cruche", la substance cruche est porteuse de la qualité qu'est le nombre "un". Le nombre "deux" est une qualité qui caractérise deux substances à la fois, et ainsi de suite. Au sujet de cette qualité, le Pdhs observe : « Le nombre est la cause de l'utilisation (des mots) "un", etc. 10». De pareilles remarques sont faites en connexion avec d'autres qualités. La "dimension" (pramana) en est une : « La dimension est la 2 3 5 6 VS 4.23 (04. Jambuvijaya) : dimasamyogas lv aviprastisiddho mithah pacanam : 4.2.3 (ed. Thakur) : almasamyoga ca pratişiddho mithah pacanam: 4.2.4 (éd. Sinha): apusamyogas Iv apratisiddhah. Quoique les lectures des soirs different considerablement, les trois commentaires arrivent à la même inter prétation Pdhs p.44 1 8-10 Puhs p. 152 L 12 54 Il se contente de dire: « Il y a plusieurs couleurs, blanc, etc. Pdhs p. 27. Le commentaire Vyomavald (ed. Gaurinath Sastri, Varanasi 1983, L. I. p63 L 20) cite pourtant un stra qu'on ne trouve pas dans les textes existants pour prouver l'existence de la couleur "bariolé". C'est le Vakyapadlya de Bharthari (Se sibcle) qui nous renseigne sur la période précédant le Pdhs : voir notre "Studies on Bharhari, 5 : Bharthari and Vaibesika", para ure. Pour la période plus récente, voir Ouo Grohma, "Theorie zur bunten Farbe im alteren Nyaya und Vallesika bis Udayana", Wiener Zeitschrif für die Kunde Südasiens 19 (1975), 147-182. 8 VS 2.1.18-19 (ed. Jambuvijaya) : samt karma iv asmadvisista lingam: pratyaksapdrvakavat umjibkarmanah. L'état des choses décrit dans ces sdtra est connu de et accepté par Palasulida: voir Pdhs p. 74 Pohs p. 16: sanam api padarthanam astitvibhidheyatvajleyatvani. Karl Potter, dans un article qui s'appelle précisément Astitva jeyatva abhidheyata "Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens 12-13 (1968), 275-280) prend cette phrase, et ses paralleles ailleurs, comme point de départ pour une discussion de notre "troisième axiome" et de ses complications. M. Pouer se trompe, pourtant, en disant que Jheyatva et abhidheyatva designent des universaux : le suffixe.vn a plusieurs fonctions en sanscrit et ne garant point qu'il y ait designation d'un universel. 10 Pths p. 111:skidivyavahtrahetuh samkhyaPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9