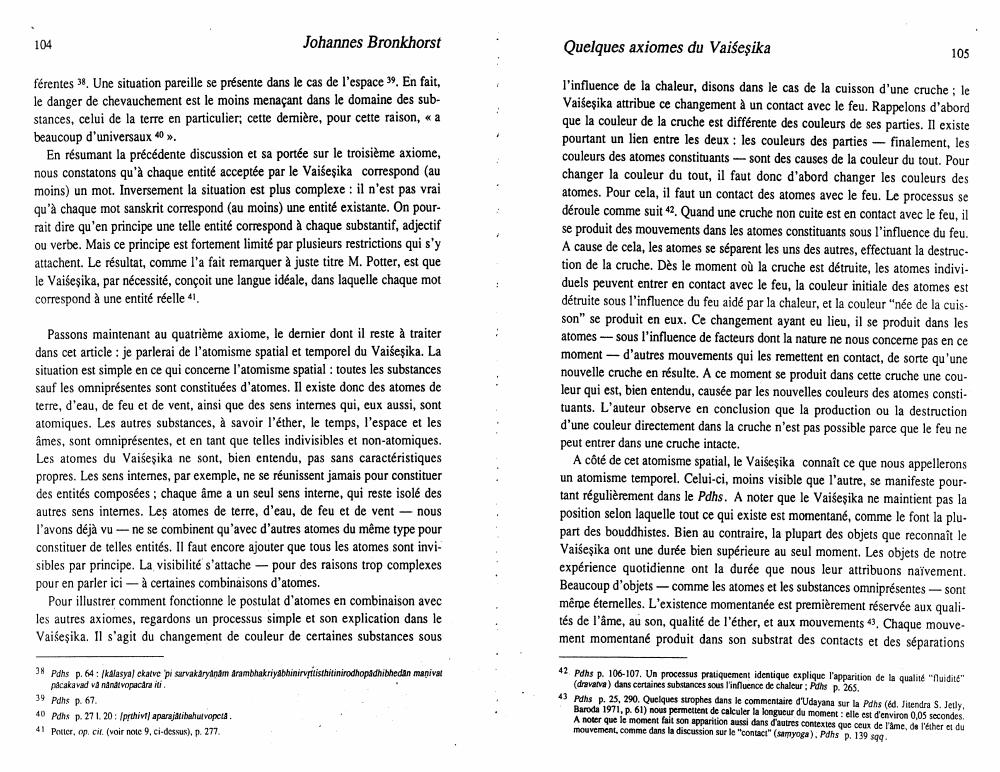Book Title: Quelques Axiomes Du Vaisesika Author(s): Johannes Bronkhorst Publisher: Johannes Bronkhorst View full book textPage 6
________________ 104 Johannes Bronkhorst Quelques axiomes du Vaišeşika 105 férentes > Une situation pareille se présente dans le cas de l'espace". En fait, le danger de chevauchement est le moins menaçant dans le domaine des substances, celui de la terre en particulier, cette dernière, pour cette raison, a beaucoup d'universaux 40». En résumant la précédente discussion et sa portée sur le troisième axiome, nous constatons qu'à chaque entité acceptée par le Vai esika correspond (au moins) un mot. Inversement la situation est plus complexe : il n'est pas vrai qu'à chaque mot sanskrit correspond (au moins) une entité existante. On pourrait dire qu'en principe une telle entité correspond à chaque substantif, adjectif ou verbe. Mais ce principe est fortement limité par plusieurs restrictions qui s'y attachent. Le résultat, comme l'a fait remarquer à juste titre M. Potter, est que le Vaisesika, par nécessité, conçoit une langue idéale, dans laquelle chaque mot correspond à une entité réelle 41 Passons maintenant au quatrième axiome, le demier dont il reste à traiter dans cet article : je parlerai de l'atomisme spatial et temporel du Vaišeşika. La situation est simple en ce qui concerne l'atomisme spatial : toutes les substances sauf les omniprésentes sont constituées d'atomes. Il existe donc des atomes de terre, d'eau, de feu et de vent, ainsi que des sens intemes qui, eux aussi, sont atomiques. Les autres substances, à savoir l'éther, le temps, l'espace et les âmes, sont omniprésentes, et en tant que telles indivisibles et non-atomiques. Les atomes du Vaišeşika ne sont, bien entendu, pas sans caractéristiques propres. Les sens intemes, par exemple, ne se réunissent jamais pour constituer des entités composées : chaque ame a un seul sens inteme, qui reste isolé des autres sens interes. Les atomes de terre, d'eau, de feu et de vent nous l'avons déjà vu - ne se combinent qu'avec d'autres atomes du même type pour constituer de telles entités. Il faut encore ajouter que tous les atomes sont invi. sibles par principe. La visibilité s'attache - pour des raisons trop complexes pour en parler ici - à certaines combinaisons d'atomes. Pour illustrer comment fonctionne le postulat d'atomes en combinaison avec les autres axiomes, regardons un processus simple et son explication dans le Vaisesika. Il s'agit du changement de couleur de certaines substances sous l'influence de la chaleur, disons dans le cas de la cuisson d'une cruche : le Vaišeșika attribue ce changement à un contact avec le feu. Rappelons d'abord que la couleur de la cruche est différente des couleurs de ses parties. Il existe pourtant un lien entre les deux : les couleurs des parties - finalement, les couleurs des atomes constituants sont des causes de la couleur du tout. Pour changer la couleur du tout, il faut donc d'abord changer les couleurs des atomes. Pour cela, il faut un contact des atomes avec le feu. Le processus se déroule comme suit. Quand une cruche non cuite est en contact avec le feu, il se produit des mouvements dans les atomes constituants sous l'influence du feu. A cause de cela, les atomes se séparent les uns des autres, effectuant la destruc. tion de la cruche. Dès le moment où la cruche est détruite, les atomes individuels peuvent entrer en contact avec le feu, la couleur initiale des atomes est détruite sous l'influence du feu aidé par la chaleur, et la couleur "née de la cuisson" se produit en eux. Ce changement ayant eu lieu, il se produit dans les atomes-sous l'influence de facteurs dont la nature ne nous conceme pas en ce moment d'autres mouvements qui les remettent en contact, de sorte qu'une nouvelle cruche en résulte. A ce moment se produit dans cette cruche une couleur qui est bien entendu, causée par les nouvelles couleurs des atomes constituants. L'auteur observe en conclusion que la production ou la destruction d'une couleur directement dans la cruche n'est pas possible parce que le feu ne peut entrer dans une cruche intacte. A côté de cet atomisme spatial, le Vaišeşika connait ce que nous appellerons un atomisme temporel. Celui-ci, moins visible que l'autre, se manifeste pour tant régulièrement dans le Pdhs. A noter que le Vaišesika ne maintient pas la position selon laquelle tout ce qui existe est momentané, comme le font la plupart des bouddhistes. Bien au contraire, la plupart des objets que reconnaît le Vaišesika ont une durée bien supérieure au seul moment. Les objets de notre expérience quotidienne ont la durée que nous leur attribuons naivement. Beaucoup d'objets -comme les atomes et les substances omniprésentes sont mêre étemelles. L'existence momentanée est premièrement réservée aux qualités de l'âme, au son, qualité de l'éther, et aux mouvements. Chaque mouve. ment momentané produit dans son substrat des contacts et des séparations IN Poh p. 64/kalasya ckatve i svakarydnam Irambhakriyathinirvítisthitinirodhopadhibhedan maniva plakavad vandnávopacara 39 Pohs p. 67. 40 Pdh p. 271. 20: prthivi aparajtihahutvopeta 41 Potter, op. cit. (voir note 9. ci-dessus), p. 277 42 Pdhe 106-107. Un processus pratiquement identique explique l'apparition de la qualité "uidité (drevaiva) dans certaines substances sous l'influence de chaleur : Php. 265. 4) M e 25. 290. Quelques serophes dans le commentaire d'Udayana sur la Pdhs (ed. Jitendra S. Jelly Baroda 1971, p. 61) nous permettent de calculer la longutur du moment : elle est d'environ 0,05 secondes. A noter que le moment fait son apparition aussi dans d'autres contextes que ceux de l'âme, de l'éther et du mouvement, comme dans la discussion sur le contact" (saryoga). Pdhs p. 139 sqq.Page Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9