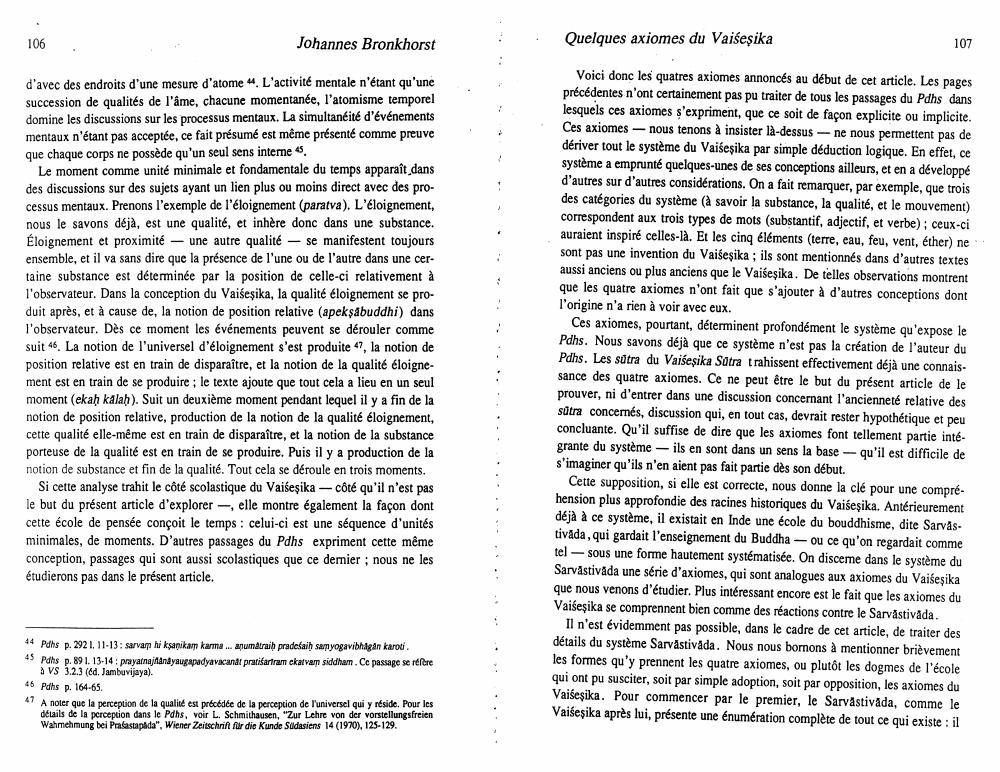Book Title: Quelques Axiomes Du Vaisesika Author(s): Johannes Bronkhorst Publisher: Johannes Bronkhorst View full book textPage 7
________________ 106 Johannes Bronkhorst Quelques axiomes du Vaibesika 107 d'avec des endroits d'une mesure d'atome . L'activité mentale n'étant qu'une succession de qualités de l'âme, chacune momentanée, l'atomisme temporel domine les discussions sur les processus mentaux. La simultanéité d'événements mentaux n'étant pas acceptée, ce fait présumé est même présenté comme preuve que chaque corps ne possède qu'un seul sens inteme Le moment comme unité minimale et fondamentale du temps apparaît dans des discussions sur des sujets ayant un lien plus ou moins direct avec des processus mentaux. Prenons l'exemple de l'éloignement (paratva). L'éloignement, nous le savons déjà, est une qualité, et inhère donc dans une substance. Éloignement et proximité - une autre qualité - se manifestent toujours ensemble, et il va sans dire que la présence de l'une ou de l'autre dans une certaine substance est déterminée par la position de celle-ci relativement à l'observateur. Dans la conception du Vaišeşika, la qualité éloignement se produit après, et à cause de la notion de position relative (apeksabuddhi) dans l'observateur. Dès ce moment les événements peuvent se dérouler comme suit 46. La notion de l'universel d'éloignement s'est produite , la notion de position relative est en train de disparaître, et la notion de la qualité éloignement est en train de se produire ; le texte ajoute que tout cela a lieu en un seul moment (ekah kalah). Suit un deuxième moment pendant lequel il y a fin de la notion de position relative, production de la notion de la qualité éloignement, cette qualité elle-même est en train de disparaître, et la notion de la substance porteuse de la qualité est en train de se produire. Puis il y a production de la notion de substance et fin de la qualité. Tout cela se déroule en trois moments. Si cette analyse trahit le côté scolastique du Vaišesika-coté qu'il n'est pas le but du présent article d'explorer - elle montre également la façon dont cette école de pensée conçoit le temps : celui-ci est une séquence d'unités minimales, de moments. D'autres passages du Pdhs expriment cette même conception, passages qui sont aussi scolastiques que ce demier ; nous ne les étudierons pas dans le présent article. Voici donc les quatres axiomes annoncés au début de cet article. Les pages précédentes n'ont certainement pas pu traiter de tous les passages du Pdhs dans lesquels ces axiomes s'expriment, que ce soit de façon explicite ou implicite. Ces axiomes-nous tenons à insister là-dessus - ne nous permettent pas de dériver tout le système du Vaišeșika par simple déduction logique. En effet, ce système a emprunté quelques-unes de ses conceptions ailleurs, et en a développé d'autres sur d'autres considérations. On a fait remarquer, par exemple, que trois des catégories du système (à savoir la substance, la qualité, et le mouvement) correspondent aux trois types de mots (substantif, adjectif, et verbe): ceux-ci auraient inspiré celles-là. Et les cinq éléments (terre, eau, feu, vent, éther) ne sont pas une invention du Vaišeşika; ils sont mentionnés dans d'autres textes aussi anciens ou plus anciens que le Vaišesika. De telles observations montrent que les quatre axiomes n'ont fait que s'ajouter à d'autres conceptions dont l'origine n'a rien à voir avec eux. Ces axiomes, pourtant, déterminent profondément le système qu'expose le Pdhs. Nous savons déjà que ce système n'est pas la création de l'auteur du Pdhs. Les sutra du Vai esika Sutra trahissent effectivement déjà une connaissance des quatre axiomes. Ce ne peut être le but du présent article de le prouver, ni d'entrer dans une discussion concernant l'ancienneté relative des sútra concernés, discussion qui, en tout cas, devrait rester hypothétique et peu concluante. Qu'il suffise de dire que les axiomes font tellement partie intégrante du système -ils en sont dans un sens la base qu'il est difficile de s'imaginer qu'ils n'en aient pas fait partie dès son début. Cette supposition, si elle est correcte, nous donne la clé pour une compréhension plus approfondie des racines historiques du Vaiśeşika. Antérieurement déjà à ce système, il existait en Inde une école du bouddhisme, dite Sarvastivada, qui gardait l'enseignement du Buddha -ou ce qu'on regardait comme tel-sous une forme hautement systématisée. On disceme dans le système du Sarvástivada une série d'axiomes, qui sont analogues aux axiomes du Vaišesika que nous venons d'étudier. Plus intéressant encore est le fait que les axiomes du Vaišesika se comprennent bien comme des réactions contre le Sarvástivada. Il n'est évidemment pas possible, dans le cadre de cet article, de traiter des détails du système Sarvästivada. Nous nous borons à mentionner brièvement les formes qu'y prennent les quatre axiomes, ou plutôt les dogmes de l'école qui ont pu susciter, soit par simple adoption, soit par opposition, les axiomes du Vaišeşika. Pour commencer par le premier, le Sarvastivada, comme le Vaišesika après lui, présente une énumération complète de tout ce qui existe : il 44 Pdhs p. 292 I. 11-13: savam i ksanikam karma... anumitrui pradelaih samyogavibhagan karoti 45 Pohs p. 891. 13-14 prayatnajitanyaugaudyavacand praisartram ekatvam siddhan. Ce passage se refere 3 VS 3.2.3 (ed. Jambuvijaya) 46 Puhs p. 164-65 47 A noter que la perception de la qualité est précédée de la perception de l'universel qui y réside. Pour les détails de la perception dans le Pdhs, voir L. Schmithausen, "Zur Lehre von der vorstellungsfreien Wahrnehmung bei Prasastapada", Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens 14 (1970), 125-129.Page Navigation
1 ... 5 6 7 8 9