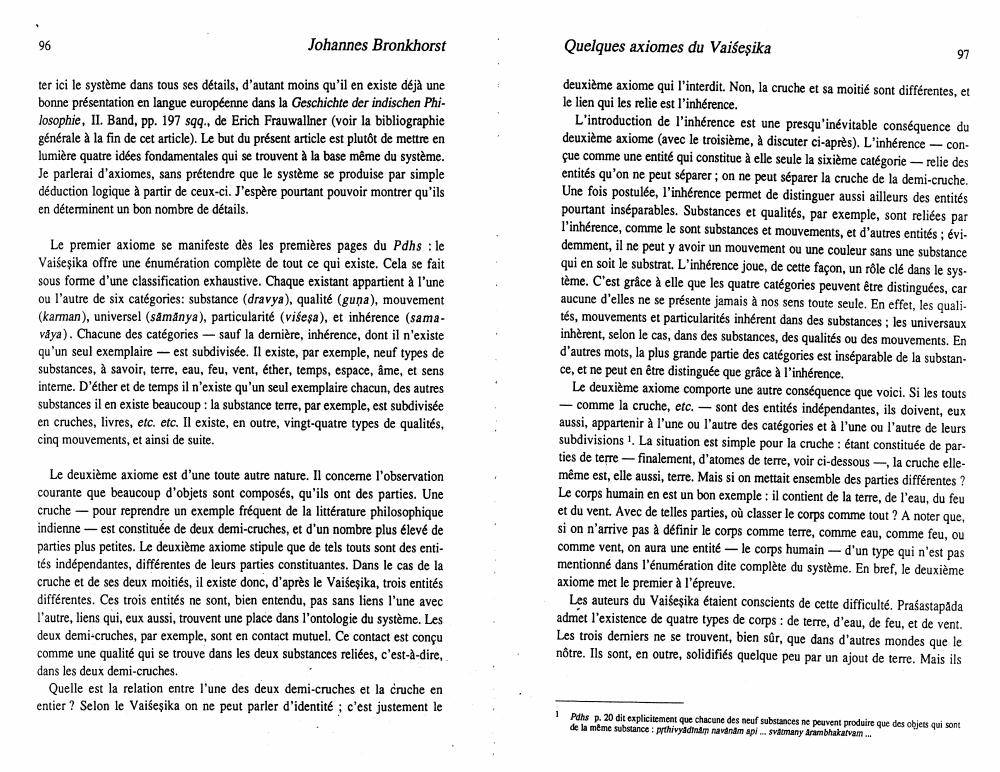Book Title: Quelques Axiomes Du Vaisesika Author(s): Johannes Bronkhorst Publisher: Johannes Bronkhorst View full book textPage 2
________________ Johannes Bronkhorst Quelques axiomes du Vaišeşika ter ici le système dans tous ses détails, d'autant moins qu'il en existe déjà une bonne présentation en langue européenne dans la Geschichte der indischen Philosophie, II. Band, pp. 197 sqq., de Erich Frauwallner (voir la bibliographie générale à la fin de cet article). Le but du présent article est plutôt de mettre en lumière quatre idées fondamentales qui se trouvent à la base même du système. Je parlerai d'axiomes, sans prétendre que le système se produise par simple déduction logique à partir de ceux-ci. J'espère pourtant pouvoir montrer qu'ils en déterminent un bon nombre de détails. Le premier axiome se manifeste dès les premières pages du Pdhs : le Vaiseșika offre une énumération complète de tout ce qui existe. Cela se fait sous forme d'une classification exhaustive. Chaque existant appartient à l'une ou l'autre de six catégories: substance (dravya), qualité (guna), mouvement (karman), universel (samanya), particularité (visesa), et inhérence (samavaya). Chacune des catégories -- sauf la dernière, inhérence, dont il n'existe qu'un seul exemplaire - est subdivisée. Il existe, par exemple, neuf types de substances, à savoir, terre, eau, feu, vent, éther, temps, espace, ame, et sens inteme. D'éther et de temps il n'existe qu'un seul exemplaire chacun, des autres substances il en existe beaucoup : la substance terre, par exemple, est subdivisée en cruches, livres, etc. etc. Il existe, en outre, vingt-quatre types de qualités, cinq mouvements, et ainsi de suite. deuxième axiome qui l'interdit. Non, la cruche et sa moitié sont différentes, et le lien qui les relie est l'inhérence. L'introduction de l'inhérence est une presqu'inévitable conséquence du deuxième axiome (avec le troisième, à discuter ci-après). L'inhérence -conçue comme une entité qui constitue à elle seule la sixième catégorie --relie des entités qu'on ne peut séparer, on ne peut séparer la cruche de la demi-cruche. Une fois postulée, l'inhérence permet de distinguer aussi ailleurs des entités pourtant inséparables. Substances et qualités, par exemple, sont reliées par l'inhérence, comme le sont substances et mouvements, et d'autres entités : évidemment, il ne peut y avoir un mouvement ou une couleur sans une substance qui en soit le substrat. L'inhérence joue, de cette façon, un rôle clé dans le système. C'est grâce à elle que les quatre catégories peuvent être distinguées, car aucune d'elles ne se présente jamais à nos sens toute seule. En effet, les qualités, mouvements et particularités inhérent dans des substances : les universaux inherent, selon le cas, dans des substances, des qualités ou des mouvements. En d'autres mots, la plus grande partie des catégories est inséparable de la substance, et ne peut en être distinguée que grâce à l'inhérence. Le deuxième axiome comporte une autre conséquence que voici. Si les touts - comme la cruche, etc.- sont des entités indépendantes, ils doivent, eux aussi, appartenir à l'une ou l'autre des catégories et à l'une ou l'autre de leurs subdivisions. La situation est simple pour la cruche : étant constituée de par. ties de terre-finalement, d'atomes de terre, voir ci-dessous la cruche ellemême est, elle aussi, terre. Mais si on mettait ensemble des parties différentes? Le corps humain en est un bon exemple: il contient de la terre, de l'eau, du feu et du vent. Avec de telles parties, où classer le corps comme tout ? A noter que, si on n'arrive pas à définir le corps comme terre, comme eau, comme feu, ou comme vent, on aura une entité - le corps humain-d'un type qui n'est pas mentionné dans l'énumération dite complète du système. En bref, le deuxième axiome met le premier à l'épreuve. Les auteurs du Vaibesika étaient conscients de cette difficulté. Prasastapada admet l'existence de quatre types de corps : de terre, d'eau, de feu, et de vent. Les trois derniers ne se trouvent, bien sûr, que dans d'autres mondes que le nôtre. Ils sont, en outre, solidifiés quelque peu par un ajout de terre. Mais ils Le deuxième axiome est d'une toute autre nature. Il concere l'observation courante que beaucoup d'objets sont composés, qu'ils ont des parties. Une cruche - pour reprendre un exemple fréquent de la littérature philosophique indienne - est constituée de deux demi-cruches, et d'un nombre plus élevé de parties plus petites. Le deuxième axiome stipule que de tels touts sont des entités indépendantes, différentes de leurs parties constituantes. Dans le cas de la cruche et de ses deux moitiés, il existe donc, d'après le Vaišeşika, trois entités différentes. Ces trois entités ne sont, bien entendu, pas sans liens l'une avec l'autre, liens qui, eux aussi, trouvent une place dans l'ontologie du système. Les deux demi-cruches, par exemple, sont en contact mutuel. Ce contact est conçu comme une qualité qui se trouve dans les deux substances reliées, c'est-à-dire, dans les deux demi-cruches. Quelle est la relation entre l'une des deux demi-cruches et la cruche en entier ? Selon le Vaišesika on ne peut parler d'identité : c'est justement le 1 P ep. 20 dit explicitement que chacune des neuf substances ne peuvent produire que des objets qui sont de la même substance: Arthivydanavanam spi... Somany Arambhakata.Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9