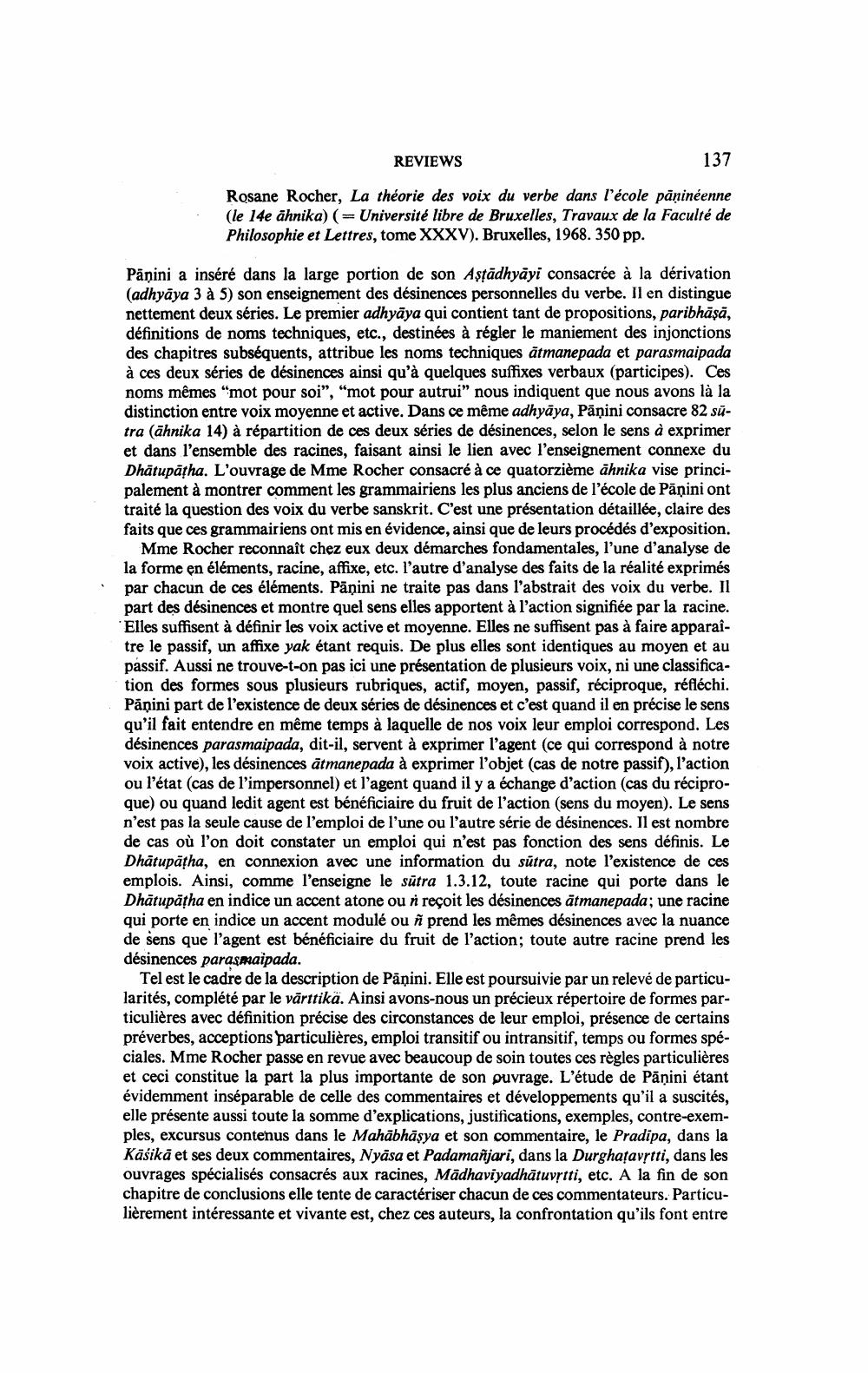Book Title: Reviews Of Different Books Author(s): Publisher: View full book textPage 1
________________ REVIEWS 137 Rosane Rocher, La theorie des voix du verbe dans l'ecole panineenne (le 14e ahnika) (= Universite libre de Bruxelles, Travaux de la Faculte de Philosophie et Lettres, tome XXXV). Bruxelles, 1968. 350 pp. Panini a insere dans la large portion de son Astadhyayi consacree a la derivation (adhyaya 3 a 5) son enseignement des desinences personnelles du verbe. Il en distingue nettement deux series. Le premier adhyaya qui contient tant de propositions, paribhasa, definitions de noms techniques, etc., destinees a regler le maniement des injonctions des chapitres subsequents, attribue les noms techniques atmanepada et parasmaipada a ces deux series de desinences ainsi qu'a quelques suffixes verbaux (participes). Ces noms memes "mot pour soi", "mot pour autrui" nous indiquent que nous avons la la distinction entre voix moyenne et active. Dans ce meme adhyaya, Panini consacre 82 sutra (ahnika 14) a repartition de ces deux series de desinences, selon le sens a exprimer et dans l'ensemble des racines, faisant ainsi le lien avec l'enseignement connexe du Dhatupatha. L'ouvrage de Mme Rocher consacre a ce quatorzieme ahnika vise principalement a montrer comment les grammairiens les plus anciens de l'ecole de Panini ont traite la question des voix du verbe sanskrit. C'est une presentation detaillee, claire des faits que ces grammairiens ont mis en evidence, ainsi que de leurs procedes d'exposition. Mme Rocher reconnait chez eux deux demarches fondamentales, l'une d'analyse de la forme en elements, racine, affixe, etc. l'autre d'analyse des faits de la realite exprimes par chacun de ces elements. Panini ne traite pas dans l'abstrait des voix du verbe. Il part des desinences et montre quel sens elles apportent a l'action signifiee par la racine. Elles suffisent a definir les voix active et moyenne. Elles ne suffisent pas a faire apparaitre le passif, un affixe yak etant requis. De plus elles sont identiques au moyen et au passif. Aussi ne trouve-t-on pas ici une presentation de plusieurs voix, ni une classification des formes sous plusieurs rubriques, actif, moyen, passif, reciproque, reflechi. Panini part de l'existence de deux series de desinences et c'est quand il en precise le sens qu'il fait entendre en meme temps a laquelle de nos voix leur emploi correspond. Les desinences parasmaipada, dit-il, servent a exprimer l'agent (ce qui correspond a notre voix active), les desinences atmanepada a exprimer l'objet (cas de notre passif), l'action ou l'etat (cas de l'impersonnel) et l'agent quand il y a echange d'action (cas du reciproque) ou quand ledit agent est beneficiaire du fruit de l'action (sens du moyen). Le sens n'est pas la seule cause de l'emploi de l'une ou l'autre serie de desinences. Il est nombre de cas ou l'on doit constater un emploi qui n'est pas fonction des sens definis. Le Dhatupatha, en connexion avec une information du sutra, note l'existence de ces emplois. Ainsi, comme l'enseigne le sutra 1.3.12, toute racine qui porte dans le Dhatupatha en indice un accent atone ou r recoit les desinences atmanepada; une racine qui porte en indice un accent module ou n prend les memes desinences avec la nuance de sens que l'agent est beneficiaire du fruit de l'action; toute autre racine prend les desinences para maipada. Tel est le cadre de la description de Panini. Elle est poursuivie par un releve de particularites, complete par le varttika. Ainsi avons-nous un precieux repertoire de formes particulieres avec definition precise des circonstances de leur emploi, presence de certains preverbes, acceptions particulieres, emploi transitif ou intransitif, temps ou formes speciales. Mme Rocher passe en revue avec beaucoup de soin toutes ces regles particulieres et ceci constitue la part la plus importante de son puvrage. L'etude de Panini etant evidemment inseparable de celle des commentaires et developpements qu'il a suscites, elle presente aussi toute la somme d'explications, justifications, exemples, contre-exemples, excursus contenus dans le Mahabhasya et son commentaire, le Pradipa, dans la Kasika et ses deux commentaires, Nyasa et Padamanjari, dans la Durghatavrtti, dans les ouvrages specialises consacres aux racines, Madhaviyadhatuvrtti, etc. A la fin de son chapitre de conclusions elle tente de caracteriser chacun de ces commentateurs. Particulierement interessante et vivante est, chez ces auteurs, la confrontation qu'ils font entrePage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15