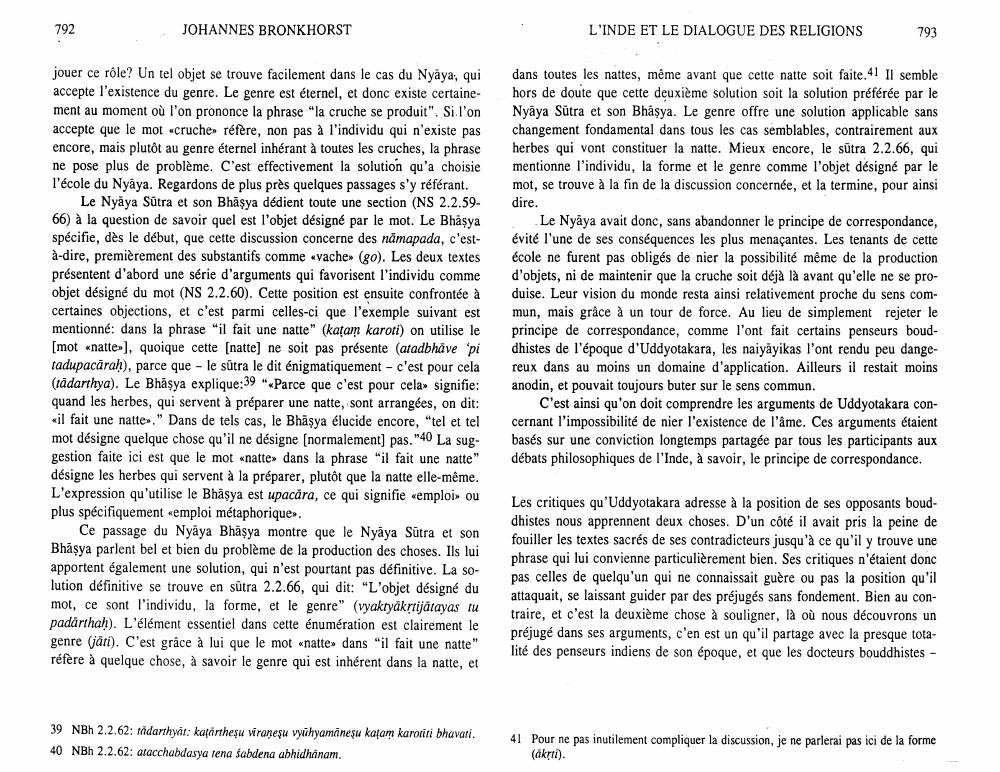Book Title: Linde Classique Et Le Dialogue Des Religions Author(s): Johannes Bronkhorst Publisher: Johannes Bronkhorst View full book textPage 8
________________ 792 JOHANNES BRONKHORST L'INDE ET LE DIALOGUE DES RELIGIONS 793 jouer ce rôle? Un tel objet se trouve facilement dans le cas du Nyāya, qui accepte l'existence du genre. Le genre est éternel, et donc existe certainement au moment où l'on prononce la phrase "la cruche se produit". Si l'on accepte que le mot «cruche réfère, non pas à l'individu qui n'existe pas encore, mais plutôt au genre éternel inhérant à toutes les cruches, la phrase ne pose plus de problème. C'est effectivement la solution qu'a choisie l'école du Nyaya. Regardons de plus près quelques passages s'y référant. Le Nyāya Sutra et son Bhāşya dédient toute une section (NS 2.2.59. 66) à la question de savoir quel est l'objet désigné par le mot. Le Bhåşya spécifie, dès le début, que cette discussion concerne des namapada, c'està-dire, premièrement des substantifs comme «vache (go). Les deux textes présentent d'abord une série d'arguments qui favorisent l'individu comme objet désigné du mot (NS 2.2.60). Cette position est ensuite confrontée à certaines objections, et c'est parmi celles-ci que l'exemple suivant est mentionné dans la phrase "il fait une natte" (katam karoti) on utilise le [mot «natte»), quoique cette (natte) ne soit pas présente (atadbhave 'pi tadupacarah), parce que le sutra le dit énigmatiquement - c'est pour cela (radarthya). Le Bhāşya explique:39 "«Parce que c'est pour cela signifie: quand les herbes, qui servent à préparer une natte, sont arrangées, on dit: «il fait une natte" Dans de tels cas, le Bhāşya élucide encore, "tel et tel mot désigne quelque chose qu'il ne désigne (normalement) pas. "40 La sug. gestion faite ici est que le mot «natte dans la phrase "il fait une natte" désigne les herbes qui servent à la préparer, plutôt que la natte elle-même. L'expression qu'utilise le Bhāşya est upacara, ce qui signifie «emploi ou plus spécifiquement «emploi métaphorique. Ce passage du Nyāya Bhāşya montre que le Nyaya Sutra et son Bhāşya parlent bel et bien du problème de la production des choses. Ils lui apportent également une solution, qui n'est pourtant pas définitive. La solution définitive se trouve en sútra 2.2.66, qui dit: "L'objet désigné du mot, ce sont l'individu, la forme, et le genre" (vyaktyákrtijätayas tu padarthah). L'élément essentiel dans cette énumération est clairement le genre (jani). C'est grâce à lui que le mot «natte dans "il fait une natte" réfère à quelque chose, à savoir le genre qui est inhérent dans la natte, et dans toutes les nattes, même avant que cette natte soit faite.41 Il semble hors de doute que cette deuxième solution soit la solution préférée par le Nyāya Sūtra et son Bhāşya. Le genre offre une solution applicable sans changement fondamental dans tous les cas semblables, contrairement aux herbes qui vont constituer la natte. Mieux encore, le sutra 2.2.66, qui mentionne l'individu, la forme et le genre comme l'objet désigné par le mot, se trouve à la fin de la discussion concernée, et la termine, pour ainsi dire. Le Nyāya avait donc, sans abandonner le principe de correspondance, évité l'une de ses conséquences les plus menaçantes. Les tenants de cette école ne furent pas obligés de nier la possibilité même de la production d'objets, ni de maintenir que la cruche soit déjà là avant qu'elle ne se produise. Leur vision du monde resta ainsi relativement proche du sens commun, mais grâce à un tour de force. Au lieu de simplement rejeter le principe de correspondance, comme l'ont fait certains penseurs bouddhistes de l'époque d'Uddyotakara, les naiyāyikas l'ont rendu peu dangereux dans au moins un domaine d'application. Ailleurs il restait moins anodin, et pouvait toujours buter sur le sens commun. C'est ainsi qu'on doit comprendre les arguments de Uddyotakara concernant l'impossibilité de nier l'existence de l'âme. Ces arguments étaient basés sur une conviction longtemps partagée par tous les participants aux débats philosophiques de l'Inde, à savoir, le principe de correspondance. Les critiques qu'Uddyotakara adresse à la position de ses opposants bouddhistes nous apprennent deux choses. D'un côté il avait pris la peine de fouiller les textes sacrés de ses contradicteurs jusqu'à ce qu'il y trouve une phrase qui lui convienne particulièrement bien. Ses critiques n'étaient donc pas celles de quelqu'un qui ne connaissait guère ou pas la position qu'il attaquait, se laissant guider par des préjugés sans fondement. Bien au contraire, et c'est la deuxième chose à souligner, là où nous découvrons un préjugé dans ses arguments, c'en est un qu'il partage avec la presque totalité des penseurs indiens de son époque, et que les docteurs bouddhistes - 39 NBh 2.2.62: tädarthyat: katinthesu viranesu vyúhyamánesu katam karotini bhavari. 40 NBh 2.2.62: atacchabdasya tena sabdena abhidhanam. 41 Pour ne pas inutilement compliquer la discussion, je ne parlerai pas ici de la forme (akrii).Page Navigation
1 ... 6 7 8 9 10