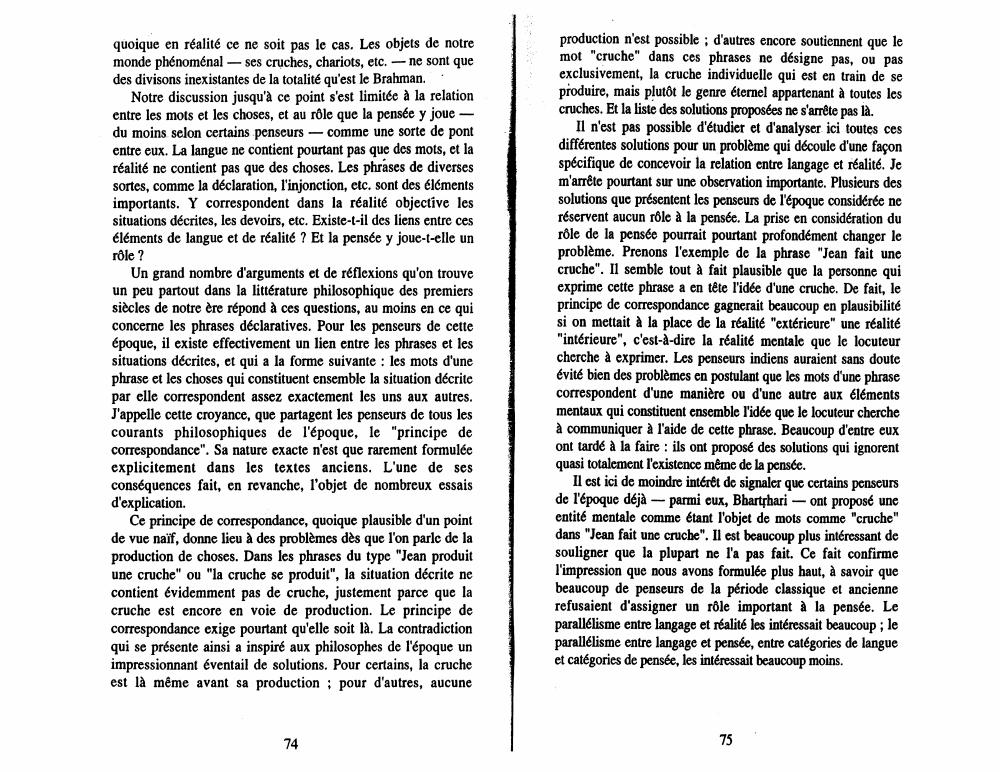________________
quoique en réalité ce ne soit pas le cas. Les objets de notre monde phénoménal - ses cruches, chariots, etc. - ne sont que des divisons inexistantes de la totalité qu'est le Brahman
Notre discussion jusqu'à ce point s'est limitée à la relation entre les mots et les choses, et au rôle que la pensée y joue - du moins selon certains penseurs - comme une sorte de pont entre eux. La langue ne contient pourtant pas que des mots, et la réalité ne contient pas que des choses. Les phrases de diverses sortes, comme la déclaration, l'injonction, etc. sont des éléments importants. Y correspondent dans la réalité objective les situations décrites, les devoirs, etc. Existe-t-il des liens entre ces éléments de langue et de réalité ? Et la pensée y joue-t-elle un rôle ?
Un grand nombre d'arguments et de réflexions qu'on trouve un peu partout dans la littérature philosophique des premiers siècles de notre ère répond à ces questions, au moins en ce qui concerne les phrases déclaratives. Pour les penseurs de cette époque, il existe effectivement un lien entre les phrases et les situations décrites, et qui a la forme suivante : les mots d'une phrase et les choses qui constituent ensemble la situation décrite par elle correspondent assez exactement les uns aux autres. J'appelle cette croyance, que partagent les penseurs de tous les courants philosophiques de l'époque, le "principe de correspondance". Sa nature exacte n'est que rarement formulée explicitement dans les textes anciens. L'une de ses conséquences fait, en revanche, l'objet de nombreux essais d'explication.
Ce principe de correspondance, quoique plausible d'un point de vue naif, donne lieu à des problèmes dès que l'on parle de la production de choses. Dans les phrases du type "Jean produit une cruche" ou "la cruche se produit", la situation décrite ne contient évidemment pas de cruche, justement parce que la cruche est encore en voie de production. Le principe de correspondance exige pourtant qu'elle soit la. La contradiction qui se présente ainsi a inspiré aux philosophes de l'époque un impressionnant éventail de solutions. Pour certains, la cruche est là même avant sa production : pour d'autres, aucune
production n'est possible ; d'autres encore soutiennent que le mot "cruche" dans ces phrases ne désigne pas, ou pas exclusivement, la cruche individuelle qui est en train de se produire, mais plutôt le genre éternel appartenant à toutes les cruches. Et la liste des solutions proposées ne s'arrête pas là.
Il n'est pas possible d'étudier et d'analyser ici toutes ces différentes solutions pour un problème qui découle d'une façon spécifique de concevoir la relation entre langage et réalité. Je m'arrête pourtant sur une observation importante. Plusieurs des solutions que présentent les penseurs de l'époque considérée ne réservent aucun rôle à la penséc. La prise en considération du rôle de la pensée pourrait pourtant profondément changer le probleme. Prenons l'exemple de la phrase "Jean fait une cruche". Il semble tout à fait plausible que la personne qui exprime cette phrase a en tête l'idée d'une cruche. De fait, le principe de correspondance gagnerait beaucoup en plausibilité si on mettait à la place de la réalité "extérieure" une réalité "intérieure", c'est-à-dire la réalité mentale que le locuteur cherche à exprimer. Les penseurs indiens auraient sans doute évité bien des problèmes en postulant que les mots d'une phrase correspondent d'une manière ou d'une autre aux éléments mentaux qui constituent ensemble l'idée que le locuteur cherche à communiquer à l'aide de cette phrase. Beaucoup d'entre eux ont tardé à la faire : ils ont proposé des solutions qui ignorent quasi totalement l'existence même de la pensée.
Il est ici de moindre intérêt de signaler que certains penscurs de l'époque déjà - parmi eux, Bharthari-ont proposé une entité mentale comme étant l'objet de mots comme "cruche" dans "Jean fait une cruche". Il est beaucoup plus intéressant de souligner que la plupart ne l'a pas fait. Ce fait confirme l'impression que nous avons formulée plus haut, à savoir que beaucoup de penseurs de la période classique et ancienne refusaient d'assigner un rôle important à la pensée. Le parallélisme entre langage et réalité les intéressait beaucoup; le parallélisme entre langage et pensée, entre catégories de langue et catégories de pensée, les intéressait beaucoup moins.
75