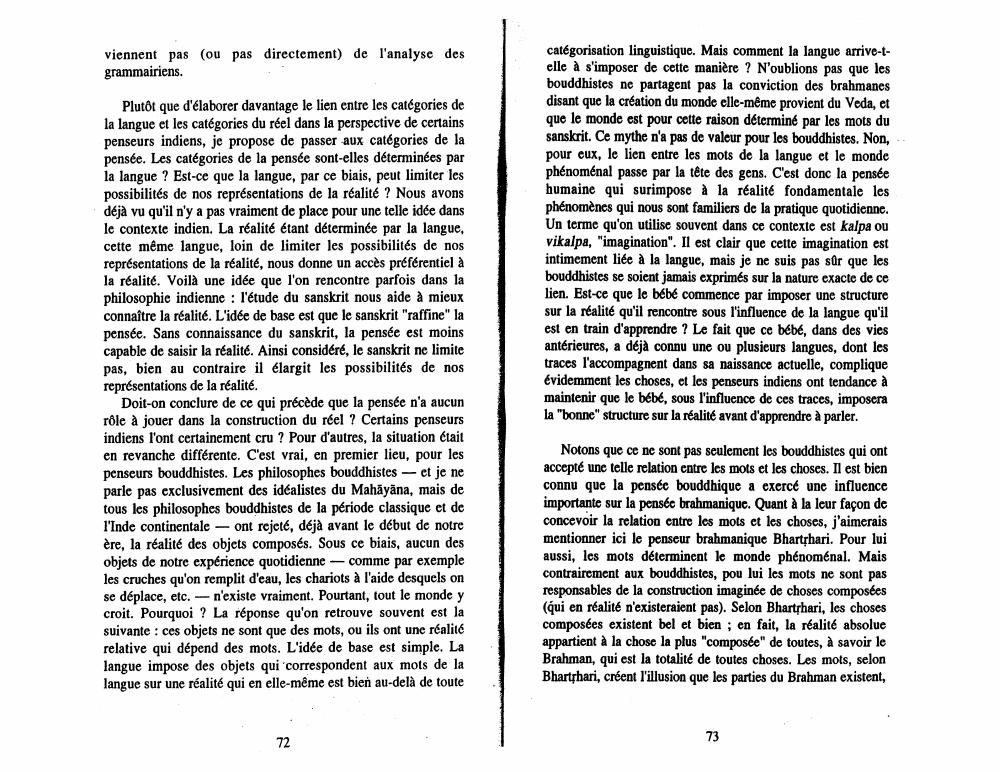________________
viennent pas (ou pas directement) de l'analyse des grammairiens.
Plutôt que d'élaborer davantage le lien entre les catégories de la langue et les catégories du réel dans la perspective de certains penseurs indiens, je propose de passer aux catégories de la pensée. Les catégories de la pensée sont-elles déterminées par la langue ? Est-ce que la langue, par ce biais, peut limiter les possibilités de nos représentations de la réalité ? Nous avons déjà vu qu'il n'y a pas vraiment de place pour une telle idée dans le contexte indien. La réalité étant déterminée par la langue, cette même langue, loin de limiter les possibilités de nos représentations de la réalité, nous donne un accès préférentiel à la réalité. Voilà une idée que l'on rencontre parfois dans la philosophie indienne : l'étude du sanskrit nous aide à mieux connaître la réalité. L'idée de base est que le sanskrit "raffine" la pensée. Sans connaissance du sanskrit, la pensée est moins capable de saisir la réalité. Ainsi considéré, le sanskrit ne limite pas, bien au contraire il élargit les possibilités de nos représentations de la réalité.
Doit-on conclure de ce qui précède que la pensée n'a aucun rôle à jouer dans la construction du réel ? Certains penseurs indiens l'ont certainement cru ? Pour d'autres, la situation était en revanche différente. C'est vrai, en premier lieu, pour les penseurs bouddhistes. Les philosophes bouddhistes - et je ne parle pas exclusivement des idéalistes du Mahāyāna, mais de tous les philosophes bouddhistes de la période classique et de l'Inde continentale - ont rejeté, déjà avant le début de notre ère, la réalité des objets composés. Sous ce biais, aucun des objets de notre expérience quotidienne - comme par exemple les cruches qu'on remplit d'eau, les chariots à l'aide desquels on se déplace, etc. -n'existe vraiment. Pourtant, tout le monde y croit. Pourquoi ? La réponse qu'on retrouve souvent est la suivante : ces objets ne sont que des mots, ou ils ont une réalité relative qui dépend des mots. L'idée de base est simple. La langue impose des objets qui correspondent aux mots de la langue sur une réalité qui en elle-même est bien au-delà de toute
catégorisation linguistique. Mais comment la langue arrive-telle à s'imposer de cette manière ? N'oublions pas que les bouddhistes ne partagent pas la conviction des brahmanes disant que la création du monde elle-même provient du Veda, et que le monde est pour cette raison déterminé par les mots du sanskrit. Ce mythe n'a pas de valeur pour les bouddhistes. Non, pour eux, le lien entre les mots de la langue et le monde phénoménal passe par la tête des gens. C'est donc la pensée humaine qui surimpose à la réalité fondamentale les phénomènes qui nous sont familiers de la pratique quotidienne. Un terme qu'on utilise souvent dans ce contexte est kalpa ou vikalpa, "imagination". Il est clair que cette imagination est intimement liée à la langue, mais je ne suis pas sûr que les bouddhistes se soient jamais exprimés sur la nature exacte de ce lien. Est-ce que le bébé commence par imposer une structure sur la réalité qu'il rencontre sous l'influence de la langue qu'il est en train d'apprendre ? Le fait que ce bébé, dans des vies antérieures, a déjà connu une ou plusieurs langues, dont les traces l'accompagnent dans sa naissance actuelle, complique évidemment les choses, et les penseurs indiens ont tendance à maintenir que le bébé, sous l'influence de ces traces, imposera la "bonne" structure sur la réalité avant d'apprendre à parler.
Notons que ce ne sont pas seulement les bouddhistes qui ont accepté une telle relation entre les mots et les choses. Il est bien connu que la pensée bouddhique a exercé une influence importante sur la pensée brahmanique. Quant à la leur façon de concevoir la relation entre les mots et les choses, j'aimerais mentionner ici le pensour brahmanique Bharthari. Pour lui aussi, les mots déterminent le monde phénoménal. Mais contrairement aux bouddhistes, pou lui les mots ne sont pas responsables de la construction imaginée de choses composées (qui en réalité n'existeraient pas). Selon Bharthari, les choses composées existent bel et bien ; en fait, la réalité absolue appartient à la chose la plus "composée de toutes, à savoir le Brahman, qui est la totalité de toutes choses. Les mots, selon Bharthari, créent l'illusion que les parties du Brahman existent,
73