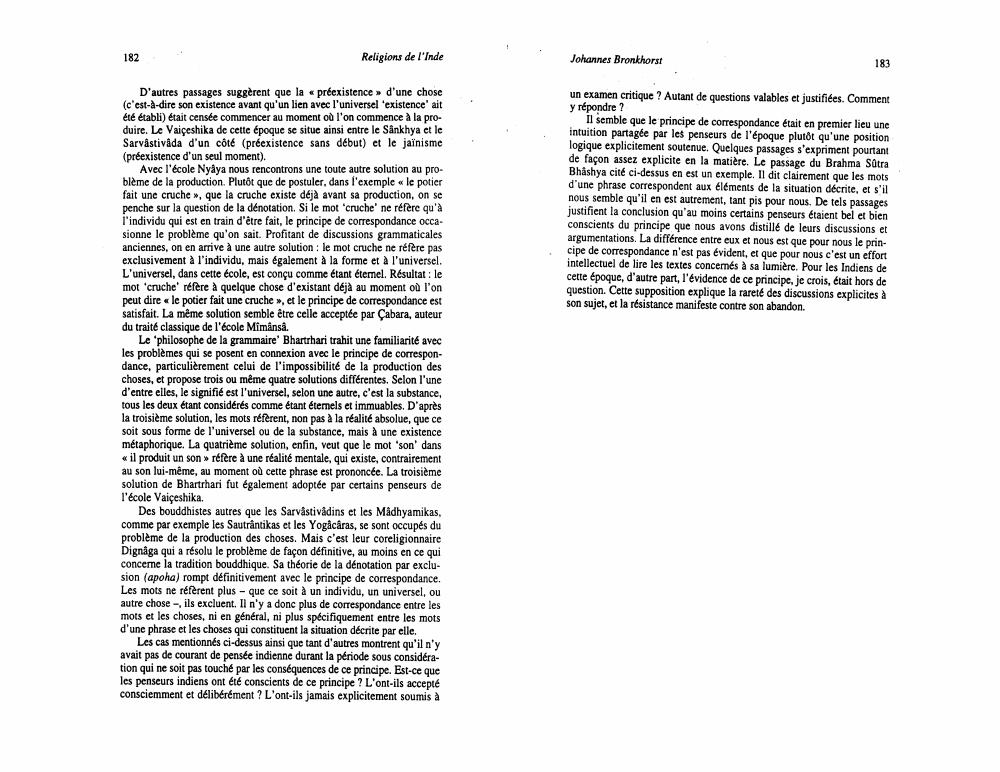Book Title: Langage Of Realite Sur Un Episode De La Pensee Indinee Author(s): Johannes Bronkhorst Publisher: Johannes Bronkhorst View full book textPage 3
________________ 182 Religions de l'Inde Johannes Bronkhorst 183 un examen critique ? Autant de questions valables et justifiees. Comment y repondre ? Il semble que le principe de correspondance etait en premier lieu une intuition partagee par les penseurs de l'epoque plutot qu'une position logique explicitement soutenue. Quelques passages s'expriment pourtant de facon assez explicite en la matiere. Le passage du Brahma Satra Bhashya cite ci-dessus en est un exemple. Il dit clairement que les mots d'une phrase correspondent aux elements de la situation decrite, et s'il nous semble qu'il en est autrement, tant pis pour nous. De tels passages justifient la conclusion qu'au moins certains penseurs etaient bel et bien conscients du principe que nous avons distille de leurs discussions et argumentations. La difference entre eux et nous est que pour nous le principe de correspondance n'est pas evident, et que pour nous c'est un effort intellectuel de lire les textes concernes a sa lumiere. Pour les Indiens de cette epoque, d'autre part, l'evidence de ce principe, je crois, etait hors de question. Cette supposition explique la rarete des discussions explicites a son sujet, et la resistance manifeste contre son abandon. D'autres passages suggerent que la << preexistence >> d'une chose (c'est-a-dire son existence avant qu'un lien avec l'universel 'existence' ait ete etabli) etait censee commencer au moment ou l'on commence a la produire. Le Vaiceshika de cette epoque se situe ainsi entre le Sankhya et le Sarvastivada d'un cote (preexistence sans debut) et le jainisme (preexistence d'un seul moment). Avec l'ecole Nyaya nous rencontrons une toute autre solution au probleme de la production. Plutot que de postuler, dans l'exemple << le potier fait une cruche >>, que la cruche existe deja avant sa production, on se penche sur la question de la denotation. Si le mot 'cruche' ne refere qu'a l'individu qui est en train d'etre fait, le principe de correspondance occasionne le probleme qu'on sait. Profitant de discussions grammaticales anciennes, on en arrive a une autre solution : le mot cruche ne refere pas exclusivement a l'individu, mais egalement a la forme et a l'universel. L'universel, dans cette ecole, est concu comme etant eternel. Resultat : le mot 'cruche' refere a quelque chose d'existant deja au moment ou l'on peut dire << le potier fait une cruche >>, et le principe de correspondance est satisfait. La meme solution semble etre celle acceptee par Cabara, auteur du traite classique de l'ecole Mimansa. Le philosophe de la grammaire' Bhartrhari trahit une familiarite avec les problemes qui se posent en connexion avec le principe de correspondance, particulierement celui de l'impossibilite de la production des choses, et propose trois ou meme quatre solutions differentes. Selon l'une d'entre elles, le signifie est l'universel, selon une autre, c'est la substance, tous les deux etant consideres comme etant eternels et immuables. D'apres la troisieme solution, les mots referent, non pas a la realite absolue, que ce soit sous forme de l'universel ou de la substance, mais a une existence metaphorique. La quatrieme solution, enfin, veut que le mot 'son' dans << il produit un son >> refere a une realite mentale, qui existe, contrairement au son lui-meme, au moment ou cette phrase est prononcee. La troisieme solution de Bhartrhari fut egalement adoptee par certains penseurs de l'ecole Vaiceshika. Des bouddhistes autres que les Sarvastivadins et les Madhyamikas, comme par exemple les Sautrantikas et les Yogacaras, se sont occupes du probleme de la production des choses. Mais c'est leur coreligionnaire Dignaga qui a resolu le probleme de facon definitive, au moins en ce qui concerne la tradition bouddhique. Sa theorie de la denotation par exclusion (apoha) rompt definitivement avec le principe de correspondance. Les mots ne referent plus - que ce soit a un individu, un universel, ou autre chose -, ils excluent. Il n'y a donc plus de correspondance entre les mots et les choses, ni en general, ni plus specifiquement entre les mots d'une phrase et les choses qui constituent la situation decrite par elle. Les cas mentionnes ci-dessus ainsi que tant d'autres montrent qu'il n'y avait pas de courant de pensee indienne durant la periode sous consideration qui ne soit pas touche par les consequences de ce principe. Est-ce que les penseurs indiens ont ete conscients de ce principe ? L'ont-ils accepte consciemment et deliberement ? L'ont-ils jamais explicitement soumis aPage Navigation
1 2 3