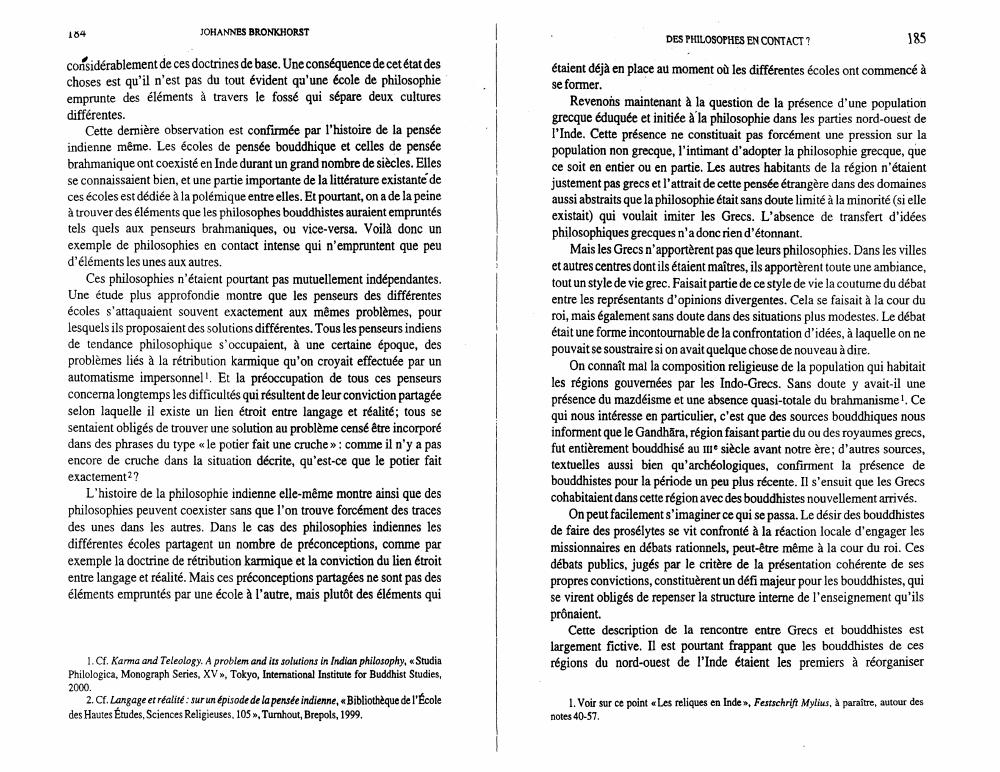________________
184
JOHANNES BRONKHORST
DES PHILOSOPHES EN CONTACT?
185
considerablement de ces doctrines de base. Une conséquence de cet état des choses est qu'il n'est pas du tout évident qu'une école de philosophie emprunte des éléments à travers le fossé qui sépare deux cultures différentes.
Cette dernière observation est confirmée par l'histoire de la pensée indienne même. Les écoles de pensée bouddhique et celles de pensée brahmanique ont coexisté en Inde durant un grand nombre de siècles. Elles se connaissaient bien, et une partie importante de la littérature existante de ces écoles est dédiée à la polémique entre elles. Et pourtant, on a de la peine à trouver des éléments que les philosophes bouddhistes auraient empruntés tels quels aux penseurs brahmaniques, ou vice-versa. Voilà donc un exemple de philosophies en contact intense qui n'empruntent que peu d'éléments les unes aux autres.
Ces philosophies n'étaient pourtant pas mutuellement indépendantes. Une étude plus approfondie montre que les penseurs des différentes écoles s'attaquaient souvent exactement aux mêmes problèmes, pour lesquels ils proposaient des solutions différentes. Tous les penseurs indiens de tendance philosophique s'occupaient, à une certaine époque, des problèmes liés à la rétribution karmique qu'on croyait effectuée par un automatisme impersonnel! Et la préoccupation de tous ces penseurs concerna longtemps les difficultés qui résultent de leur conviction partagée selon laquelle il existe un lien étroit entre langage et réalité; tous se sentaient obligés de trouver une solution au problème censé être incorporé dans des phrases du type «le potier fait une cruche»: comme il n'y a pas encore de cruche dans la situation décrite, qu'est-ce que le potier fait exactement2?
L'histoire de la philosophie indienne elle-même montre ainsi que des philosophies peuvent coexister sans que l'on trouve forcément des traces des unes dans les autres. Dans le cas des philosophies indiennes les différentes écoles partagent un nombre de préconceptions, comme par exemple la doctrine de rétribution karmique et la conviction du lien étroit entre langage et réalité. Mais ces préconceptions partagées ne sont pas des éléments empruntés par une école à l'autre, mais plutôt des éléments qui
étaient déjà en place au moment où les différentes écoles ont commencé à se former.
Revenons maintenant à la question de la présence d'une population grecque éduquée et initiée à la philosophie dans les parties nord-ouest de l'Inde. Cette présence ne constituait pas forcément une pression sur la population non grecque, l'intimant d'adopter la philosophie grecque, que ce soit en entier ou en partie. Les autres habitants de la région n'étaient justement pas grecs et l'attrait de cette pensée étrangère dans des domaines aussi abstraits que la philosophie était sans doute limité à la minorité (si elle existait) qui voulait imiter les Grecs. L'absence de transfert d'idées philosophiques grecques n'a donc rien d'étonnant.
Mais les Grecs n'apportèrent pas que leurs philosophies. Dans les villes et autres centres dont ils étaient maîtres, ils apportèrent toute une ambiance, tout un style de vie grec. Faisait partie de ce style de vie la coutume du débat entre les représentants d'opinions divergentes. Cela se faisait à la cour du roi, mais également sans doute dans des situations plus modestes. Le débat était une forme incontournable de la confrontation d'idées, à laquelle on ne pouvait se soustraire si on avait quelque chose de nouveau à dire.
On connaît mal la composition religieuse de la population qui habitait les régions gouvernées par les Indo-Grecs. Sans doute y avait-il une présence du mazdéisme et une absence quasi-totale du brahmanisme!. Ce qui nous intéresse en particulier, c'est que des sources bouddhiques nous informent que le Gandhāra, région faisant partie du ou des royaumes grecs, fut entièrement bouddhisé au que siècle avant notre ère; d'autres sources, textuelles aussi bien qu'archéologiques, confirment la présence de bouddhistes pour la période un peu plus récente. Il s'ensuit que les Grecs cohabitaient dans cette région avec des bouddhistes nouvellement arrivés.
On peut facilement s'imaginer ce qui se passa. Le désir des bouddhistes de faire des prosélytes se vit confronté à la réaction locale d'engager les missionnaires en débats rationnels, peut-être même à la cour du roi. Ces débats publics, jugés par le critère de la présentation cohérente de ses propres convictions, constituèrent un défi majeur pour les bouddhistes, qui se virent obligés de repenser la structure interne de l'enseignement qu'ils prônaient
Cette description de la rencontre entre Grecs et bouddhistes est largement fictive. Il est pourtant frappant que les bouddhistes de ces régions du nord-ouest de l'Inde étaient les premiers à réorganiser
1. C. Karma and Teleology. A problem and its solutions in Indian philosophy, «Studia Philologica, Monograph Series, XV, Tokyo, International Institute for Buddhist Studies, 2000.
2. C. Langage et réalité : sur un épisode de la pensée indienne, «Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Sciences Religieuses, 105 , Turnhout, Brepols, 1999.
1. Voir sur ce point «Les reliques en Inde, Festschrift Mylius, à paraître, autour des notes 40-57.